Histoire de la Cour de cassation du Niger

La Cour de Cassation

M.IBRAHIM MALAM MOUSSA, Premier avocat général près la Cour de cassation, auteur du texte sur l'histoire de la Cour de cassation du Niger
La Cour de cassation est la plus haute juridiction judiciaire du Niger. Son histoire est intimement liée à celle du droit, elle-même inséparable de l’histoire sociopolitique de la République du Niger.
Dans le territoire correspondant à l’actuel Niger, vivaient depuis des temps immémoriaux, diverses populations dans une certaine harmonie, qui n’a pu régner que parce que les rapports étaient régis par un ensemble de règles juridiques. Ce sont là les exigences de la vie en commun, inhérentes à toute vie en société et cela depuis l’apparition de la vie humaine1 .
C’est dire que les notions de droit et de justice sont connues de nos sociétés de longue date. Cependant, la justice ou plus précisément l’organisation judiciaire telle qu’elle se conçoit de nos jours, ne date que de l’intervention du fait colonial, suivi de la formation d’un État centralisé, la République du Niger2.
Ainsi donc, avant l’avènement de la cour de cassation dans sa forme actuelle, résultat de diverses mutations, deux périodes sont à distinguer : la période précoloniale et la période coloniale.
Ainsi donc, avant l’avènement de la cour de cassation dans sa forme actuelle, résultat de diverses mutations, deux périodes sont à distinguer : la période précoloniale et la période coloniale.
La période précoloniale
Le territoire correspondant au Niger actuel, était peuplé par de nombreux petits Etats plus ou moins organisés et vivant en autarcie relative. Le colonisateur n’avait pas trouvé un terrain vierge, car ces populations avaient un système juridique et judiciaire qui permettait de régler les conflits qui pouvaient exister aussi bien entre les micro Etats qu’entre leurs populations.
Même si peu d’études ont été réalisées sur le sujet, il n’est pas juste, comme certains l’ont affirmé, de dire qu’avant la colonisation il n’existait aucune organisation judiciaire au Niger3.
A vrai dire, les contentieux étaient simples. Cette simplicité n’a pas rendu nécessaire, la mise en place d’une architecture judiciaire complexe. Les décisions étaient rendues par les chefs coutumiers, qui pouvaient être de village, de famille ou de clan. Le droit applicable était aussi simple et avait pour base un certain nombre de principes à savoir entre autres, celui de la parole donnée, celui du droit d’aînesse, la bonne foi et l’intérêt du groupe, par les rois, les chefs de clans, de tribus ou de villages. Les décisions ne semblaient pas être soumises aux voies de recours, car l’autorité d’un chef ne se conteste pas. De nos jours certains chefs coutumiers continuent à voir d’un mauvais œil, l’éventualité que leur décision soit déférée devant un juge.
Cette absence de voies de recours contre les décisions rendues par de telles instances, n’était en rien préjudiciable à leur qualité. En effet, nul doute qu’une des fins du droit en tout lieu est d’abord la paix sociale. Celle-ci peut être obtenue de différentes façons.
Il n’y avait pas de hiérarchie entre les différentes « juridictions », mais il existait plutôt une complémentarité. Seules les affaires importantes mettant en péril la paix de la chefferie ou du royaume devaient être portées à la connaissance de son supérieur hiérarchique, le sultan.
Pour souligner l’existence d’une justice dans le Niger ancien, Kimba Idrissa affirmait, « qu’avant l’occupation française, le droit de rendre justice occupait une place prépondérante parmi les privilèges dont les souverains tiraient le plus d’orgueil. Le droit, fait social relevant de l’histoire et phénomène communautaire, existait bien dans les sociétés précoloniales. A côté de la religion, la morale, l’éthique, il modelait et disciplinait les comportements. Les européens n’avaient rien apporté. Ils transformèrent le dispositif existant ».
Sur un autre plan, dans beaucoup de contrées, il est incontestable que le droit musulman était déjà adopté et les différentes cours de chefferies avaient leurs cadis qui officiaient au nom du sultan ou du chef.
Accepter la religion musulmane permettait d’accéder à un nouveau statut valorisant. Dans cette perspective, se soumettre à la juridiction du cadi était très favorablement accueilli.
Les décisions des cadis n’étaient pas susceptibles de recours et étaient directement exécutoires. Il ne se posait pas fondamentalement un problème d’accessibilité, car la justice était omniprésente, tout près de l’autorité locale. Il n’y avait ou presque pas de procédure ou lorsqu’elle existait elle était connue de tous, car orale et très simple. Nous verrons plus tard que la procédure écrite du droit moderne reste toujours hors de la portée de la majorité de nigériens, pauvres et analphabètes et n’est pas sans conséquence sur l’issue de beaucoup de procès.
Le contentieux était composé essentiellement des affaires matrimoniales et peu fourni en matière civile et commerciale à cause de l’inexistence d’une véritable économie de marché.
Il n’y a pas assez de données sur la justice répressive.
La période coloniale
C’est une période peu reluisante, pour le moins qu’on puisse dire, de notre histoire. La colonisation française avait ses objectifs et toutes ses interventions dans les divers domaines de la vie sociale, devaient tendre à leur réalisation.
La population était d’abord scindée en deux groupes. Un premier groupe de personnes de citoyenneté française, relevant du droit français et un second n’ayant pas la citoyenneté française, soumis au statut de l’indigénat.
Le régime de l’indigénat était instauré dans toutes les colonies françaises pour les autochtones qui étaient réduits à de citoyens de seconde zone. Ils étaient rendus taillables et corvéables à merci.
Le colonisateur a instauré une dualité de juridictions en raison du statut des uns et des autres. Les citoyens français d’une part et les autochtones5 relevant du statut de l’indigénat d’autre part.
Ce n’était pourtant pas ce qu’auguraient les déclarations de principe précédant la colonisation.
« Au début de la conquête, la France proclama de manière solennelle dans une longue série d’actes successifs, qu’elle entendait maintenir les institutions des pays et spécialement les institutions juridiques. Le principe ne fut cependant pas appliqué sans réserve. Les décrets pris en cette matière en 1892, 1894 et 1896 tout en respectant l’organisation de la famille et de la propriété confiaient néanmoins la justice répressive à des juges européens chaque fois qu’il s’agissait de faits qualifiés de crime ». 6
Les litiges relevant du statut personnel n’intéressaient pas outre mesure le colonisateur et étaient laissés aux mains des autochtones. Les cadis7 qui officiaient à la cour des chefs et appliquaient essentiellement le droit musulman. En effet, compte tenu de l’implantation précoce de l’islam, un bon nombre de corpus de textes de droit musulman était déjà maîtrisé depuis des générations.
La justice du cadi était si bien acceptée qu’à Zinder, lorsqu’un tribunal pour païen fut créé, personne ne dut se réclamer de statut païen et relever de ce tribunal. Ne trouvant pas de justiciable à juger ce tribunal fut tout simplement fermé8 .
Les autorités du pays conquis, ainsi écartées, ne s’occupaient plus que des infractions mineures : litiges familiaux et fonciers.
Une petite évolution les amenait à s’occuper de la répression des flambées de troubles des années 1902. Il leur était dorénavant permis de juger tout conflit, mais devaient soumettre à la chambre spéciale d’homologation de Kayes toutes les affaires requérant une peine supérieure à une année d’emprisonnement.
Le décret de 1902, révéla les limites de la nouvelle réglementation. L’introduction des formes compliquées du droit français, l’insuffisance et l’incompétence des magistrats professionnels profondément ignorants de l’organisation sociale, donnèrent lieu à des errements. Un nouveau décret pris le 10 novembre 1903 réorganisa la justice dans les colonies et territoires relevant de l’Afrique Occidentale Française (AOF). Il était rendu applicable au territoire militaire du Niger par le décret du 20 décembre 1907. Trois hiérarchies de tribunaux furent constituées : tribunaux de villages, tribunaux de province et tribunaux de cercle9.
- Les tribunaux de village présidés par le chef de village, sont investis du pouvoir de conciliation en matière civile et commerciale, sans préjudice d’une phase contentieuse éventuelle. En matière de simple police, ils statuent en premier et dernier ressort sur toutes contraventions prévues par l’autorité administrative ou les coutumes locales passibles de 1 à 15 francs d’amende et de 1 à 15 jours d’emprisonnement.
- Les tribunaux de province sont présidés par le chef de poste ou l’adjoint au commandant de cercle assisté de deux notables nommés chaque année comme assesseurs et deux suppléants. Ils étaient compétents pour les affaires qui dépassent la compétence des tribunaux de village en matière civile, commerciale et correctionnelle.
- Les tribunaux de cercle sont présidés par le commandant de cercle assisté de quatre assesseurs dont deux titulaires et deux suppléants. Ils jugent en appel les affaires renvoyées par l’échelon inférieur10.
- La chambre spéciale d’homologation de Kayes, composée de trois conseillers à la cour, de deux fonctionnaires et de deux assesseurs locaux11, reçoit l’appel des jugements rendus par les tribunaux de province. Elle peut les confirmer ou les casser pour vice de forme, de compétence, d’abus de pouvoir etc. …
C’était la justice indigène, très sommaire avec une simplification des procédures à l’extrême. Le personnel était constitué essentiellement de cadis qui collaboraient avec des sous-officiers de l’armée coloniale faisant fonction de secrétaire de tribunaux.
La justice indigène n’avait pas de façon générale changé grand-chose dans le quotidien des sujets qui devaient toujours faire face aux dures réalités du code de l’indigénat 12.
Pour les citoyens français et assimilés13 , ils relevaient de la justice française ; celle-ci est organisée autour :
• d’une cour d’appel par colonie en AOF : Sénégal, Guinée, Cote d’ivoire, Dahomey, et Haut Sénégal-Niger ;
• des tribunaux de première instance à Dakar et St Louis (Sénégal) , à Conakry (Guinée ), à Grand –Bassam (Côte d’ivoire) et à Cotonou (Dahomey) ;
• Des justices de paix à compétence étendue dans les centres autres que ceux abritant les cours d’appel et les tribunaux de première instance. Ainsi la justice de paix à compétence étendue de Niamey fut installée le 1er juillet 1907.
La situation allait évoluer pour aboutir à une unification de la structure. L’unité dans la diversité sera consacrée par une dualité de statuts : droit coutumier pour les citoyens régis par la coutume et droit écrit pour les citoyens régis par le droit écrit. Il était toutefois attendu, que les coutumes allaient évoluer pour se rapprocher à terme, du droit moderne.
C’est à peu près la situation qui régnait à la veille des indépendances.
Au lendemain des indépendances
Au lendemain des indépendances, les pays africains ont eu à cœur de se doter de nouvelles institutions répondant au mieux aux aspirations de leurs peuples, et surtout pour marquer l’avènement de l’ère de la souveraineté nationale nouvellement acquise.
Le Niger, à l’instar des autres pays, allait mettre en place un système judiciaire adapté à la nouvelle citoyenneté acquise et dans l’intérêt de sa population.
A la place de l’embryon de justice hérité de la période coloniale, va bientôt se dresser de façon progressive et évolutive l’architecture d’une nouvelle justice.
Pour l’essentiel, l’architecture héritée de la période coloniale était maintenue et dans certains cas, adaptée. L’organisation judiciaire calquée sur le modèle français comprenait deux ordres, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Comme dans tous les pays africains, l’une des premières taches des nouveaux gouvernants, était de légiférer ou d’adapter les textes à la nouvelle situation qu’ils sont désormais censés régir.
La problématique du droit applicable
Au lendemain de l’indépendance, le pays héritait des textes coloniaux et les accords et traités internationaux auxquels la France a souscrit en raison du principe de la succession d’Etat.
Les choses n’étaient pourtant pas assez simples. En effet dans cet enchevêtrement inextricable de textes, il n’était pas aisé de distinguer ce qui est applicable de ce qui ne l’est pas.
En raison de la règle dite de la spécialité législative, les textes promulgués en France métropolitaine n’étaient pas directement applicables dans les colonies. Il faudrait en plus, qu’un arrêté du gouverneur les rende applicables en colonie.
A titre d’exemple, jusqu’à une date récente, il n’existait pas de code de procédure civile, tout au plus un recueil dit « Bouvenet » (Gaston Jean Bouvenet, auteur du recueil), contenant l’essentiel des textes rendus expressément applicables en AOF. Ce même recueil Bouvenet faisait état des textes applicables implicitement, d’autres à titre de raison écrite. Un véritable cocktail de dispositions de nature à dérouter les juristes les mieux avertis.
La cour suprême a eu elle-même à prendre certaines décisions, par rapport à la question, qualifiées d’ inconciliables ou contradictoires par certains acteurs14 .
Le même problème se pose par rapport à la jurisprudence française, que certains juges n’hésitent pas à citer dans leurs décisions, en violation flagrante de l’interdiction faite au juge de statuer par des dispositions générales. Il s’avère par ailleurs assez incongru, pour une juridiction comme la cour de cassation dont les décisions sont appelées à fixer la jurisprudence, donc à avoir un caractère normatif, de se référer à une décision d’un autre juge situé outre méditerranée. C’est le problème de la délicate question de l’attelage au droit français, qui préoccupe tout juge africain de l’ancien dominion français.
A cela s’ajoute l’épineuse question de la coutume des personnes à statut coutumier. Comme la question concerne l’écrasante majorité de la population, un compromis fut trouvé. Les juridictions coutumières doivent continuer à exister aux cotés des juridictions de droit commun. La coutume accède à un statut de norme juridique au même titre que la loi. Les juridictions de fond qui vont devoir l’appliquer, seront assistées d’assesseurs coutumiers. La loi exigera que l’énoncé de la coutume appliquée soit fait dans chaque affaire de façon à ce que la cour suprême, juridiction de cassation puisse jouer pleinement son rôle de régulateur en uniformisant l’interprétation. Les défis étaient de plusieurs ordres, institutionnels, personnels judiciaires, infrastructures, inadéquation des textes…
La question cruciale du personnel
Dans un pays où tout était prioritaire, les autorités vont choisir d’aller à un rythme qui tienne compte des possibilités en ressources mobilisables.
L’état des lieux est parlant, en 1960, il n’y avait presque aucun magistrat de carrière de nationalité nigérienne. Le personnel judiciaire était essentiellement constitué d’anciens élèves de l'institut des hautes études outre-mer, qui étaient en plus des administrateurs et des secrétaires des greffes et parquets. Les premiers assumaient les plus hautes fonctions dans les juridictions de fond, tandis que les fonctions de juges de paix étaient assumées par les greffiers et autres secrétaires des greffes et parquets.
A la création de la cour suprême qui allait suivre, les fonctions de juges étaient assumées par des coopérants français15. Le premier nigérien à occuper le poste de président est nommé en 1971 16.
Le premier président nigérien fut Diallo Ousmane Bassarou, qui était un administrateur civil, suivi de Monsieur Mamadou Malam Aouami, premier magistrat de carrière à diriger la cour suprême.
Le premier nigérien à occuper le poste de greffier en chef près la cour suprême était Chaibou Abdou en 1970.
Jusqu’en 1980, un conseiller de la coopération française siégeait à la cour d’Etat.
La création de la Cour suprême
La Cour suprême fut créée par la constitution du 08 novembre 1960, et la loi n°61-28 du 15 juillet 1961 déterminait sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement.
Elle comprenait quatre chambres à savoir la chambre constitutionnelle, la chambre judiciaire, la chambre administrative et la chambre des comptes17, et allait fonctionner tant bien que mal pendant plusieurs années, avant de subir des perturbations liées à une succession de coups d’Etat.
Dès le 15 avril 1974, date du coup d’État ayant mis fin à la première République, la Cour suprême était supprimée par abrogation de l’article 57 de la constitution du 15 juin 1961 qui la prévoyait. L’ordonnance 74-04 du 15 mai 1974 supprimait la constitution ainsi que la loi du 15 juillet 1961 prise en application de ladite constitution et relative à la Cour. Elle prévoyait néanmoins que les chambres administrative et judiciaire allaient continuer à fonctionner jusqu’à la mise sur pied d’une nouvelle juridiction suprême.
La cour suprême est remplacée par une cour d’Etat18 . Celle-ci était organisée en une chambre unique, la chambre judiciaire, en lieu et place de trois chambres qui se partageaient le contentieux.
C’était pour tenir compte de la nouvelle réalité caractérisée par :
- la suppression de la constitution, donc point besoin d’une chambre constitutionnelle, dont l’essentiel des compétences est le contentieux électoral auquel s’ajoute de rares interventions sur la constitutionnalité des lois.
- la coexistence d’une chambre judiciaire et d’une chambre administrative ne se justifiait plus puisque depuis l’intervention de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, un seul ordre de juridiction est institué.
- Le délicat problème d’effectifs rendait illusoire alors, une séparation des chambres qui ne pourraient pratiquement pas fonctionner 19.
La procédure aussi était simplifiée pour tenir compte du caractère analphabète de l’écrasante majorité des justiciables, auxquels il était permis en matière coutumière20 d’interjeter pourvoi par simple déclaration orale au greffe, sans obligation de constitution d’avocat. La conséquence est souvent catastrophique.
Etant en régime d’exception, la cour avait la particularité d’être placée sous l’autorité du Ministre de la justice, qui devait ainsi noter et les magistrats du parquet et ceux du siège21
Après une quinzaine d’années sous le régime d’exception, le pays allait renouer avec les institutions démocratiques et s’était doté d’une nouvelle constitution le 24 septembre 198922.
Une nouvelle cour suprême allait voir le jour suivant la loi 90-10 du 13 juin 1990 et installée le 08 octobre 1990 23. Elle comprenait toutes les chambres de l’ancienne cour suprême sauf la chambre des comptes, qui ne put être créée faute de personnel spécialisé.
A cette époque le personnel était en totalité nigérien, mais toujours numériquement insuffisant
Le 29 juillet 1991 allait intervenir la conférence nationale souveraine qui suspendait à nouveau la constitution mais maintenait la cour suprême dans ses attributions non constitutionnelles24 .
Le pays se dotait d’une nouvelle constitution (26 décembre 1992) qui créait une cour suprême.
Il n’y aura pas de changements notables avec la cour suprême précédente.
C’est sur ces entrefaites qu’intervenait le coup d’Etat du 26 janvier 1996. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la constitution fut suspendue. Une cour d’Etat fut à nouveau créée et servira de juridiction suprême jusqu’à l’adoption d’une nouvelle constitution le 12 mai 1997.
La cour suprême était créée sur le modèle de celle de 199025 . L’art 2 de l’ordonnance 96-01 du 30 janvier 1996 portant organisation des pouvoirs pendant la période de transition prévoyait en son art 12 : « la cour suprême est maintenue dans la formation actuelle. Cependant sa chambre constitutionnelle est suspendue ».
Le 09 avril 1999, les autorités de la 4è République sont renversées par un coup d’Etat. La constitution est suspendue et la cour suprême est maintenue dans ses attributions non constitutionnelles. La cour suprême est dissoute et une cour d’Etat est créée toujours sur le même modèle que celui de 199026. Les auteurs du coup d’Etat ne semblent pas eux aussi reprocher grand-chose à l’institution suprême qu’ils maintenaient quasi intégralement.
Une constitution est adoptée le 18 juillet 1999, dont l’art 16 prévoyait une cour suprême. La loi 2000-10 du 14 aout 2000 en déterminera, la composition, les attributions et le fonctionnement.
En réalité la constitution de la 6è République n’a pas créé une nouvelle cour suprême. Elle a disloqué l’ancienne et l’a remplacée par trois juridictions suprêmes à savoir : la cour de cassation, la cour des comptes et un conseil d’Etat, pour la première fois au Niger.
En attendant la mise en place de ces institutions, la cour suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions 27. Ces différentes cours ne seront jamais installées. En effet, le 18 février 2010, un coup d’Etat militaire, intervenait et mettait un terme aux velléités de troisième mandat du président Tandja. La constitution est à nouveau suspendue28. La cour suprême est dissoute tout simplement, sans dispositions transitoires dans l’attente des textes qui doivent régir la nouvelle cour d’Etat créée.
Pendant plus d’un mois un malaise s’était emparé des membres de la cour qui ne comprenaient plus leur situation. Devaient-ils cesser toute activité et rentrer chez eux ou rester malgré tout et assurer la continuité du service judiciaire.
Une assemblée générale tranche pour la seconde solution et les magistrats maintenaient le service des audiences ainsi que toutes les activités de l’ancienne cour, jusqu’à l’avènement d’une nouvelle cour. Pour la majorité des magistrats, la junte militaire, qui aurait dû s’inspirer de l’attitude de ces prédécesseurs, en pareille circonstance, a probablement été mal conseillée, et n’a pu laisser un si grand vide institutionnel que par inadvertance. Il revient alors aux hauts magistrats, qui représentent quand bien même le pouvoir judiciaire, de faire montre d’un minimum de fermeté pour sauver ce qui peut l’être et assurer la continuité du service judiciaire.
Fort heureusement, l’ordonnance déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la cour d’Etat intervenait le 16 avril 2010.
Après une transition d’un an, une nouvelle constitution de la 7è République 29 est votée, entérinant l’organisation actuelle des hautes juridictions en cour constitutionnelle, cour de cassation 30, conseil d’Etat et cour des comptes.
Quelques présidents de la Cour suprême
Diallo Ousmane Bassarou Président de la Cour Suprême 1962-1974
Mamadou Malam Aouami Président de la Cour d’Etat de 1984 à 1990, Président de la Cour Suprême de 1990 à 1993, puis de 2000 à 2005
Boubey Oumarou Président de la Cour Suprême 1993-1996
Des défis pour la Cour de cassation
Avoir un siège approprié, il ne peut y avoir justice sereine dans un environnement serein. Les locaux actuels qui ne sont pas destinés à abriter une cour 31 font souvent l’objet de modifications pour créer tantôt un bureau supplémentaire, tantôt une bibliothèque, tantôt une salle d’audience…sans jamais obtenir l’harmonie recherchée que si le bâtiment était conçu initialement à l’effet de servir de cour :
- Se faire connaître par la publication de ses décisions dans des recueils accessibles à l’ensemble des nigériens, en ne négligeant pas les moyens modernes de diffusion.
- Assurer la formation continue de ses membres.
- Jouer pleinement son rôle d’unificateur de la jurisprudence et de l’interprétation de la loi au plan national.
Un observateur de la scène judiciaire a ainsi constaté que la cour donne une portée variable au principe de la spécialité législative, ce qui l’amène à rendre des décisions contradictoires
Accès à la Cour
Pour rendre la Cour de cassation accessible à tous les citoyens, le législateur n’a pas rendu le recours au ministère d’un avocat obligatoire. Le pourvoi est interjeté très simplement par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en matière pénale et en matière coutumière. Ensuite un mémoire est déposé par la partie elle-même ou par son conseil.
En matière civile il est interjeté par requête écrite déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en dernier ressort. La même requête doit, un mois suivant son dépôt au greffe, être signifiée au défendeur par exploit d’huissier, sous peine de déchéance.
En pratique nous constatons un fort taux de pourvoi contre les décisions rendues en matière coutumières, très probablement par ce que les demandeurs continuent à penser qu’ils ont affaire à un troisième degré de juridiction. Pour cette raison beaucoup sont dans l’incapacité de formuler des moyens de droit, et produisent des mémoires où ils se contentent de relater les faits souverainement appréciés par les premiers juges, s’exposant ainsi à un rejet certain.
La Cour n’a pas une maîtrise totale de la gestion du personnel, aussi bien magistrat qu’administratif dont la nomination se fait toujours au gré de la chancellerie 32. Dans les prochaines réformes, le premier président de la Cour de cassation, premier chef de l’ institution qui incarne le pouvoir judiciaire, devait avoir plus de pouvoirs en ce domaine33.
Notes de bas de page
1) Jean Louis Bergel. Théorie Générale du droit. Dalloz.4è édit 2003. P.167
2) Proclamation du 18 décembre 1958.
3) Rapport PARJ cabinet Thalès. Niamey.2005.
4) Kimba Idrissa , la formation de la colonie du Niger 1880-1922, thèse, université Paris VII tome1.
5) Décret du 30 septembre 1887 qui confère aux administrateurs du Sénégal, des pouvoirs disciplinaires distincts des pouvoirs judiciaires sur les populations ne disposant pas de la nationalité française. Ce décret autorisait à punir sommairement certaines infractions sans recourir à des cours de justice et d’imposer de sanctions allant jusqu’à 15 jours d’emprisonnement et 100f d’amende.
6) Kimba Idrissa op cité. P413.
7) Cadi ou alkali est un jurisconsulte chargé du règlement des litiges dans les cours des chefs.
8) Gilbert Vieillard, les coutumiers juridiques de L’AOF.
9) Idrissa Kimba op cité.
10) De 1909 à 1911 étaient érigés en tribunaux de cercle du territoire militaire du Niger : Tillabéri, Niamey,Tawa, Dosso ,Zinder, Agadès, Nguigmi, Bilma , Madawa.
11) Kayes se trouve actuellement au Mali.
12) Les instructions d’un gouverneur disaient : « …qu’il ne fallait pas accorder trop d’importance à la procédure…la nouvelle organisation judiciaire ne vise en aucun cas à modifier le décret du 30 septembre 1887… vos attributions en matière d’indigénat demeurent les mêmes comme dans le passé…le terme procédure ne doit pas être pris dans le sens du langage juridique métropolitain qui implique l’idée de difficultés de complications, de processus dilatoire, de prolongation de procès, d’invalidités et autres traits qui sont incompatibles avec la simplicité de la justice indigène. La procédure est limitée aux formalités qui sont strictement indispensables pour une solution rapide et efficace des cas » A.N.S série M79, instructions du gouverneur du Sénégal aux administrateurs de la Sénégambie-Niger sur l’application du décret du 10 novembre1903 portant réorganisation du service de justice.
13) Les autres européens et les africains ayant un statut de citoyens, les tirailleurs sénégalais.
14) Djibril Abarchi « les vicissitudes des sources du droit » université de Niamey.
15) Ont servi à la cour suprême en qualité de magistrat Messieurs : Bernard Ponnou Delaffon, Jean Marie Bonnecase, Bry André, Jean LOUIS Peraud, Claude Herduin, Théodore Nimar, Pourrochottamin Velandi, Georges Salles, Jean Nier, Viaud.
16) Il s’agit de Diallo Bassarou, un administrateur, suivi de Mamadou Aouami, suivi de Ali Bandiaré, de Boube Oumarou, de Abba moussa issoufou, de Fatimata Bazèye, de Abdou Zakari, puis Oumarou YAYE et en fin Bouba Mahamane.
Jusqu’en 1980 un conseiller de la coopération française siégeait à la cour d’Etat.
17) La chambre des comptes devait faire l’objet d’un texte ultérieur devant fixer sa composition, son organisation et sn fonctionnement.
18) Ordonnance 74-13 du 13 aout 1974 portant création composition, organisation, attribution et fonctionnement de la cour d’Etat. JORN 1974.p-672.
19) A l’époque, la cour ne comptait pas plus de trois ou quatre magistrats permanents.
20) Généralement en matière de statut personnel, litiges fonciers ruraux et même en matière pénale.
21) Art 1 de l’ordonnance du 13 août 1974.
22) Constitution du 24 septembre 1989. JORN spécial du 06 octobre 1989.
23) Loi 90-10 du 13 juin 1990 déterminant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême.
24) Art 9 de l’acte III de la conférence nationale.
25) Loi 90-10 du 13 juin 1990 op citée.
26) Art 12 de l’ord 99-001 du 11 avril 1999, portant organisation des pouvoirs pendant la période de transition.
27) Art 157 de la constitution de la 6è République.
28) Ord 2010-003 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition.
29) Constitution du
30) Loi 2013-03 du 23 janvier 2013.
31) La cour n’a jamais bénéficié de locaux neufs. En 1961 c’était un ancien bâtiment de… en 1981 ce fut l’ancien local abritant l’OPEN qui a été affecté à la cour suprême.
32) Art de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation.
33) Cela ne fut toujours pas le cas. Au cours des régimes d’exception l’autorité du garde des sceaux était de façon omniprésente au-dessus des magistrats. Avec la transition de 1999, la cour d’Etat était créée sous l’autorité du ministre de la justice qui notait ainsi tous les magistrats.
Bibliographie
1. Maryse Raynal. Docteur en droit. Les institutions judiciaires du Niger. Déc.1990 ;
2. Jean Louis Bergel. Théorie Générale du droit. Dalloz .4è édition 2003 ;
3. Jean Jacques Taisne. Les institutions judiciaires. Dalloz. 8è édition.2002 ;
4. Jean Louis Mouralis. La cour d’Etat juridiction suprême de la République du Niger .in Revue Economica 1986 ;
5. Djibril Abarchi, Docteur en droit privé. Les vicissitudes des sources du droit, Faculté des sciences économiques et juridiques. Niamey-Niger ;

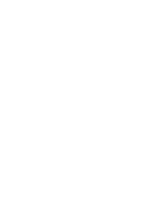 Voir les dossiers thématiques
Voir les dossiers thématiques

